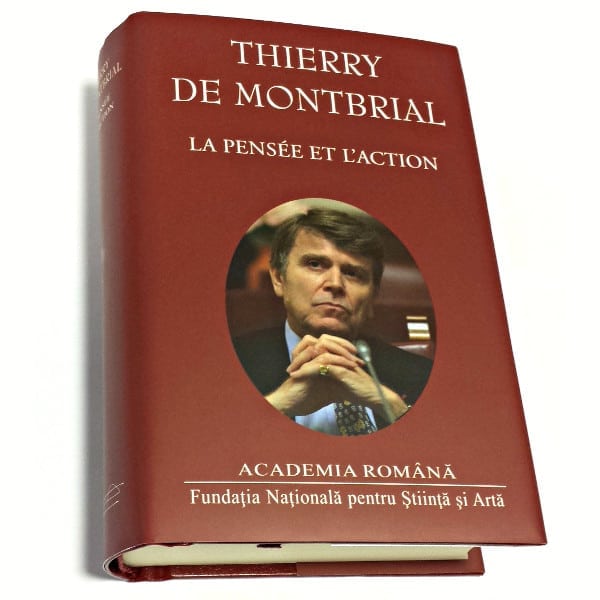La géopolitique entre guerre et paix
Leçon finale » donnée par l’auteur à l’amphithéâtre Henri-Poincaré de l’École polytechnique, le 7 mai 2009
Pour cette leçon dite finale, nous avons choisi un titre un peu ésotérique : « La géopolitique entre guerre et paix ».
Pendant les années où j’ai été professeur dans cette maison, j’ai enseigné deux disciplines : l’économie entre 1969 et 1995, puis, jusqu’en 2008, la « géopolitique » ou plus précisément la stratégie et les relations internationales. Je pense qu’il y a continuité entre les deux disciplines. Si je me suis intéressé très tôt à l’économie, c’est pour une raison que j’ai partagée avec mon maître Maurice Allais, prix Nobel de science économique en 1988 : il faut utiliser l’intelligence humaine pour tenter d’éviter les malheurs collectifs. Maurice Allais, né en 1911, a été marqué par la Première Guerre mondiale où son père a trouvé la mort, et plus tard par la Grande Dépression, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler ces derniers temps. La Grande Dépression de l’entre-deux-guerres fut l’une des causes les plus fondamentales – pour parler comme Thucydide – du second conflit mondial, en conjugaison avec d’autres facteurs liés aux conditions de sortie de la Grande Guerre.
S’agissant de ce qu’on appelle vulgairement – j’y reviendrai – la géopolitique, je m’y suis plongé à la suite d’un épisode décisif de mon histoire personnelle qui m’a conduit à participer à la création en 1973 du Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères (rebaptisé tout récemment Direction de la Prospective) et à en être le premier directeur. Je me suis lancé dans cette aventure l’année de mon élection comme professeur « titulaire » à Polytechnique, avec exactement la même motivation, à partir de cette interrogation existentielle : comment l’intelligence humaine peut-elle être employée pour éviter les grands malheurs, les grands fléaux ? Je dirais là d’une manière un peu simpliste : comment éviter la guerre, dans son acception la plus tragique ? Vous commencez sans doute à voir poindre les raisons du titre de cet exposé : la géopolitique entre guerre et paix. Mais, de même que la prospérité économique, la paix ne se décrète pas avec de bons sentiments. Ces questions doivent être étudiées de façon approfondie, à partir de l’observation et de l’étude de la réalité.
L’idéologie du progrès est née au XVIIIe siècle. Il est de bon ton aujourd’hui de la remettre en cause et de nier la possibilité même d’un progrès humain. En ce qui me concerne, je veux croire à la possibilité du progrès. Je veux y croire autant sur le plan du développement personnel que sur celui de la construction collective. Il faut – c’est d’ailleurs l’une des grandes difficultés de la vie – trouver un équilibre entre le réalisme, qui engage à regarder lucidement des choses pas toujours très belles, et l’idéal, auquel on ne doit jamais renoncer. Jean Jaurès disait : « Il faut partir du réel pour aller à l’idéal. » Souvent, on fait l’inverse. Si vous partez de l’idéal en oubliant le réel, vous courrez à l’échec. Partir du réel et aller à l’idéal, c’est le principe qui inspire toute ma démarche, aussi bien dans l’ordre de l’économie que dans celui de la politique internationale.
Qu’est-ce que le progrès ? Sur le plan individuel, c’est un mouvement intérieur par lequel, disait André Gide, on suit sa pente en montant. Plus de deux millénaires avant l’écrivain français, Confucius affirmait que le véritable but de la vie est de se perfectionner : « L’honnête homme remonte sa pente, l’homme vulgaire la descend ». C’est quelque chose de profondément personnel, qui peut avoir une dimension spirituelle, mais qui passe aussi par les institutions collectives, notamment par l’éducation. C’est largement au niveau de l’éducation que se tisse le lien entre l’aspect personnel et l’aspect collectif.
Sur le plan collectif, je crois que la mise en œuvre de l’idée de progrès passe par la construction d’institutions au sens le plus large du terme. Je vous rappelle que le mot institution est riche, puisqu’il contient à la fois un aspect virtuel et un aspect réel. Par exemple, l’institution du mariage a une dimension sociologique et une dimension juridique (création de droits). Les institutions s’expriment généralement par des unités actives (j’expliquerai bientôt ce terme) et donc par des organisations.
Nous vivons un temps fascinant, mais celui qui vient le sera plus encore, parce que l’accélération de l’histoire est une réalité. Tout ne va-t-il pas trop vite ? Pour assurer l’avenir du genre humain, il faut – je dis bien il faut –, se hâter de construire des institutions susceptibles de canaliser le torrent. C’est tout le problème de la gouvernance. Et je crois qu’il faut également réfléchir davantage qu’on ne le fait aux formes d’organisations collectives les plus aptes à favoriser l’épanouissement individuel, les chemins de vie auxquels je faisais allusion à l’instant avec d’autres termes, ce qui implique d’aller bien au-delà de la répétition pavlovienne de slogans sur la démocratie et les droits de l’homme, dont se satisfont souvent les donneurs de leçons.
Quelques mots sur l’économie, puisque l’économie et la politique, en particulier la politique internationale, sont étroitement mêlées. Vous le voyez bien ces temps-ci avec la grande crise économico-financière dans laquelle le monde a plongé en 2008.
Il me semble que le développement de la science économique, particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale ou en tout cas depuis les années 1940, a plus ou moins explicitement poursuivi le grand objectif que je vous ai indiqué en me référant à Maurice Allais. Simplement, les économistes ont péché par orgueil. Ils ont déclaré prématurément victoire. Dans les années 1980, me trouvant au MIT dans le bureau de Paul Samuelson, l’un des plus grands économistes du XXe siècle, je demandai à mon éminent interlocuteur comment il jugeait l’état d’avancement de sa discipline et les services qu’elle pouvait rendre. Samuelson me répondit avoir vécu lui-même jusque très récemment – très récemment à l’époque de notre conversation – dans l’illusion que cette science se rapprocherait de plus en plus de la mécanique classique, c’est-à-dire d’une situation où la formalisation mathématique à partir de quelques principes très simples, en combinaison avec le bon usage des données empiriques, permettrait de contrôler les trajectoires concrètes, afin d’atteindre des objectifs tels que : l’utilisation efficace des ressources, ce qui implique en particulier le plein-emploi des ressources humaines ; la stabilité du niveau général des prix, sans laquelle les calculs économiques sont faussés ; une juste répartition des revenus, sachant que la compatibilité entre efficacité et justice ne va pas de soi ; ou encore ce que j’appellerais d’une manière générale la stabilité structurelle du système, c’est-à-dire la continuité des trajectoires dans leur ensemble par rapport aux chocs ou perturbations affectant le système lui-même. Notez incidemment que les notions économiques de croissance ou de développement sont potentiellement incluses dans l’idée d’utilisation efficace des ressources.
Il était clair, avant même la tourmente actuelle, que les connaissances accumulées par les théoriciens de l’économie n’avaient pas permis d’atteindre ces objectifs. Mais l’hypothèse d’un retour à des formes de crise comparables à celle des années 1930 était exclue par l’immense majorité des économistes. Pas par tous, mais on écoute rarement les esprits libres, ceux que les Anglo-saxons appellent les mavericks. Ce que nous vivons actuellement, c’est une crise systémique qui viole le principe de stabilité structurelle dont je parlais à l’instant.
Ces remarques nous conduisent à la notion de gouvernance, laquelle pose avec acuité la question des institutions. Les modalités de la gouvernance de l’économie financière se sont progressivement dégradées au cours des deux dernières décennies. En raison d’une interprétation idéologique de la notion d’efficacité maximale, les dirigeants publics – banques centrales ou responsables économiques des grands États – ont relâché les contraintes prudentielles comme les ratios de fonds propres. On a déraisonnablement laissé se développer toutes les combinaisons concevables à partir des mathématiques financières – où l’École polytechnique a beaucoup donné – et des technologies de l’information. Ainsi a-t-on fabriqué des produits financiers de plus en plus complexes, de plus en plus inintelligibles. On s’est mis à acheter et à vendre des « boîtes » dont on ignorait le contenu, à l’encontre des principes de transparence et de traçabilité (comme on dit par exemple dans le domaine agricole), proclamés par ailleurs comme fondamentaux… Derrière tout cela se cache un grave péché contre l’esprit : dans l’usage que l’on a fait des mathématiques financières, à commencer par la fameuse formule de Black et Scholes, on a pris les modèles pour la réalité.
Ainsi a-t-on engendré des interactions – au cœur de la notion de système – non maîtrisables. On a joué à l’apprenti sorcier. On peut ainsi légitimement considérer que la faillite des systèmes financiers – faillite qui s’est manifestée à certains moments par un blocage complet (le marché interbancaire ne fonctionnait plus…) et dont les conséquences sur l’économie réelle sont sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale –, n’est pas due principalement aux erreurs des agents individuels, comme les banques commerciales ou les hedge funds, mais à celles des institutions collectives. C’est à cette conclusion, au demeurant, que parvient une grande autorité comme Jacques de Larosière, dans un rapport destiné à la Commission européenne . On en revient donc à la notion de gouvernance. Il n’y a pas de tâche plus urgente, pour l’économie politique, que d’examiner comment reconstruire des systèmes institutionnels permettant d’assurer une bonne gouvernance économique et financière au sens que j’ai essayé de définir. La tâche n’est pas simple, en raison de la diversité culturelle entre les États et du poids des lobbies.
Entre la politique et l’économie, il y a continuité. J’ai rappelé tout à l’heure que les causes de la Seconde Guerre mondiale s’analysent comme une combinaison d’erreurs économiques (d’où la Grande Dépression) et d’erreurs politiques (les « mauvais traités » de 1919 et 1920). J’en arrive ainsi à la géopolitique. Que signifie ce mot ?
Blaise Pascal écrit dans sa Première lettre aux Provinciales : « Je ne dispute jamais du nom, pourvu qu’on m’avertisse du sens qu’on lui donne. » Fort longtemps avant lui, Socrate disait à Critias : « Pour ma part, je t’accorde le droit de définir chaque mot comme tu l’entends, pourvu que tu m’indiques clairement à quoi tu rapportes le mot que tu prononces, quel qu’il soit ! »
Le géographe Yves Lacoste est justement reconnu en France pour son rôle dans la renaissance de la géopolitique. Pour accéder à la notoriété, il est parfois tentant d’employer des formules un peu extrêmes… Ainsi Lacoste a-t-il un jour déclaré « La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre », en se basant sur le fait que, dans l’histoire de la cartographie, les considérations militaires ont toujours été importantes. Songez à l’époque de Napoléon où les cartes étaient fort approximatives. Pendant ses campagnes, l’Empereur devait à chaque pas envoyer des unités de reconnaissance pour analyser le terrain. J’évoquerai aussi une époque plus récente, quand le général de Gaulle a lancé la « force de frappe ». Moscou était alors un objectif pour les armes nucléaires françaises. Au début, les missiles suivaient des trajectoires balistiques. Les missiles guidés ne sont apparus que dans les années 1970. Pour effectuer un tir balistique et atteindre le Kremlin, il fallait atteindre la perfection dans les conditions initiales du tir, dans les corrections liées aux facteurs atmosphériques, etc. Cela soulevait bien des problèmes, mais il y avait une difficulté préalable, qui était d’« acquérir Moscou » – c’est-à-dire de localiser cette ville avec la précision nécessaire. Les cartes serviraient d’abord à faire la guerre. Du moins était-ce le point de vue d’Yves Lacoste, lequel en vérité n’y a jamais cru entièrement, car il y a tout de même quelques autres intérêts – y compris la connaissance pure – à disposer de bonnes cartes ! Ainsi, sans la passion d’Henri le Navigateur pour la géographie et pour la navigation, le royaume du Portugal ne se serait pas lancé à la conquête des océans dès le début du XVe siècle. Le commerce a évidemment constitué une motivation profonde à la découverte et à la cartographie du monde. D’ailleurs, il serait tout aussi facile de dire « la technologie, ça sert d’abord à faire la guerre », et l’on pourrait décliner indéfiniment la formule.
Dans un sens beaucoup plus profond, la géopolitique a longtemps été pensée comme une discipline au service exclusif de la guerre. Ceci parce que la notion même de géopolitique a pris son essor dans le contexte allemand de la fin du XIXe siècle et de la première partie du XXe. Ce qu’on a appelé la « géopolitique allemande » a servi de support à des doctrines liées, au moins psychologiquement, au nazisme. Pour cette raison, l’idée même de géopolitique a été rejetée pendant des décennies. En fait, jusqu’aux années 1980, personne ne parlait plus de géopolitique. Au Centre d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay, dans les années 1970, nous parlions de « politique internationale » ou de « stratégie ». Les choses ont changé il y a environ un quart de siècle, au point qu’aujourd’hui on parle de géopolitique à propos de tout et de rien. On est parfois obligé de céder à la mode. À l’Ifri, nous avons des programmes qui s’appellent « Géopolitique de ceci ou de cela », tout simplement parce que si on les nommait autrement, nos partenaires y prêteraient moins attention. Le marketing repose en partie sur la sémantique. Ainsi, avons-nous un programme « Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie ». Dans l’absolu, je préférerais parler de politique internationale de l’énergie.
À un certain niveau de réflexion, il faut être rigoureux dans les termes. Je vais vous donner ma propre définition de la géopolitique : c’est le domaine de l’idéologie relative aux territoires. La géopolitique allemande, c’était cela. Au passage, j’attire votre attention sur un piège. Il est stupide d’affirmer que les idéologies ont disparu. On entend souvent dire que les idéologies ont disparu depuis la chute de l’Union soviétique. Quelle erreur ! Nous baignons dans un environnement idéologique, et je crois que l’homme ne peut pas vivre sans idéologie. Les idéologies ne sont pas forcément négatives. La construction européenne en cours depuis le traité de Rome de 1957 est un projet idéologique. Pour Destutt de Tracy (1754 – 1836), une idéologie était tout simplement un système d’idées. En tant que citoyen, j’adhère à l’idéologie de la construction européenne, pour des raisons dont beaucoup sont liées à la notion de gouvernance. Mais en tant qu’analyste, je prends mes distances et je reconnais : c’est une idéologie. Étant à la fois citoyen et analyste, je dois me dédoubler. J’admets naturellement que d’autres puissent avoir des visions différentes, et qu’il faille débattre. Le débat oblige chacun à aller jusqu’au bout de ses idées. L’organisation de débats sur ce genre de sujets est d’ailleurs l’une des fonctions majeures d’une institution comme l’Ifri. Tous les nationalismes qui fleurissent de par le monde sont également des idéologies. Quand on reconstruit l’histoire autour de mythes fondateurs, on fait de l’idéologie… Il est essentiel d’être lucide et capable de se dédoubler. Surtout, ne croyons pas que nous puissions nous affranchir complètement des idéologies.
Je vais maintenant vous infliger une petite batterie conceptuelle que j’ai développée dans mes cours des dernières années à l’École, et qui, je l’espère, permet d’aller plus loin dans l’analyse des problèmes – notamment en vue de la construction institutionnelle –, qu’il s’agisse d’économie ou de politique, avec dans les deux cas des objectifs tels qu’un emploi efficace des ressources et la stabilité structurelle.
Il faut partir de la notion d’unité active. Une unité active, c’est un groupe humain structuré par une Culture (avec un grand C) commune, qui fait l’unité de ce groupe, et une Organisation (avec un grand O) qui fait que ce groupe est capable de définir son « intérêt » et de prendre des décisions collectives, aussi bien vis-à-vis de l’extérieur que de l’intérieur.
J’appelle unité politique une unité active qui se considère souveraine. La souveraineté est au niveau politique ce que la propriété est au niveau économique. Être souverain, c’est ne reconnaître aucune autorité supérieure. Quand je dis : « qui se considère souveraine », cela veut dire que l’unité en question n’est pas nécessairement reconnue comme telle par les autres. Du point de vue du droit international, les États sont souverains parce qu’ils se considèrent souverains et parce qu’ils sont reconnus comme tels par les autres. Ceci, néanmoins, avec des restrictions, de même que pour la propriété. Si un État est membre de l’Organisation des Nations unies, il admet a priori un certain nombre de restrictions à sa souveraineté. Le principe de base n’en est pas moins la souveraineté. Mais il existe des unités actives révolutionnaires, qui se considèrent souveraines et ne sont pas reconnues comme telles par les autres. Al-Qaïda en est un bon exemple. Au nom de Dieu – Dieu a souvent bon dos dans les affaires politiques – cette unité ne reconnaît aucune autorité supérieure à la sienne. J’appelle donc unité politique une unité active qui se considère souveraine.
Pour un État, la Culture est le ciment national ; l’Organisation, c’est le gouvernement. C’est le gouvernement qui formule l’intérêt général – dans ce cas on dit aussi intérêt national – et qui prend les décisions correspondantes. Du point de vue du droit international, un État, c’est : un territoire, une population, un gouvernement. Pour une entreprise – une entreprise est une unité active –, ce sont par exemple le conseil d’administration et le management, dont la « structure » se traduit typiquement par un organigramme, qui constituent l’Organisation. Notez – à propos de la notion de structure – que beaucoup d’unités actives s’analysent en un ensemble interdépendant et partiellement hiérarchisé de sous-unités actives aux fonctions bien définies. Ces sous-unités échangent des informations dont la finalité est d’assurer la cohésion et la stabilité structurelle de l’ensemble. Ainsi peut-on parler de la structure des États ou des entreprises avec les systèmes qui leur sont associés, et procéder à des classements par homologie. À ce niveau de la réflexion, les métaphores pertinentes sont davantage dans l’ordre de la biologie que dans celui de la mécanique ou de l’énergétique. Dans les années 1960, en France, les Facultés de droit et des sciences économiques, sous l’influence du courant structuraliste alors très puissant, dispensaient des enseignements intitulés « systèmes et structures économiques », malheureusement eux-mêmes fort peu structurés, faute d’un cadre conceptuel adéquat.
J’appelle problème praxéologique (du grec praxis et logos) tout problème de décision relatif à l’interaction d’un ensemble d’unités actives, et problème politique un problème praxéologique où existe une unité politique dominante. Par exemple, si vous prenez l’ensemble de toutes les entreprises sur un territoire donné, on voit immédiatement surgir une unité politique dominante qui est l’État, dont la prise en compte est inévitable pour toute analyse fine. Nous sommes donc là – paradoxalement pour certains – dans le domaine des problèmes politiques. Enfin, j’appelle problème international tout problème praxéologique dans lequel existent au moins deux unités politiques dominantes distinctes. Il faudrait définir plus précisément certains des termes que j’emploie – par exemple, le mot dominance –, mais le sens est assez intuitif et je n’insiste pas. De même, on conçoit aisément que les unités politiques, comme d’ailleurs en général les unités actives, soient plus ou moins fragiles. Dans un empire, la Culture est typiquement faible, et l’unité ne peut être maintenue que par une Organisation forte. À l’inverse, une Nation homogène peut tolérer un gouvernement faible. L’Union européenne est une unité politique d’un type nouveau en voie de formation, dont la Culture est encore fracturée et dont l’Organisation progresse aussi lentement que douloureusement (échec du projet constitutionnel, difficultés de ratification du traité de Lisbonne).
J’appelle système international, d’une manière générale, l’ensemble des problèmes internationaux, tel qu’on peut l’identifier à un moment donné. Cette notion est plus riche que celle, trop restrictive, fondée sur le concept habituel de système. En pratique, un problème international, cela peut être aussi bien l’organisation d’un système de sécurité collective sur le continent européen, que la question du règlement de la navigation sur le Danube, laquelle fait intervenir un ensemble identifiable d’unités actives non politiques et l’ensemble des États riverains du fleuve Danube.
Les unités actives sont actives parce qu’elles ont des ressources. On doit distinguer deux grandes familles de ressources : les ressources morales et les ressources matérielles. Les ressources matérielles correspondent à peu près à ce que les économistes appellent les facteurs de production. Les plus grands des stratégistes, en tête desquels je citerai Clauzewitz – j’appelle stratégiste un penseur de la stratégie et stratège un acteur de la stratégie –, soulignent l’importance des ressources morales. Si vous disposez d’abondantes ressources matérielles mais avec un mauvais moral, vous ne pouvez guère aller loin. À l’inverse, avec des ressources morales puissantes, certains parviennent à compenser l’insuffisance de leurs ressources matérielles. Les économistes ont mis du temps à s’intéresser à cette notion essentielle que les écoles de management ont intégrée depuis longtemps.
On retrouve ici l’idéologie dans laquelle il faut voir un aspect de la ressource morale. Dans les pays où une idéologie nationaliste ou patriotique très puissante existe, il peut y avoir un multiplicateur de forces – autre locution empruntée au vocabulaire de la stratégie –, pour le meilleur ou pour le pire. Je faisais tout à l’heure allusion au nazisme. Un pays dont l’idéologie ou les ressources morales sont faibles, souffre d’un désavantage majeur par rapport à un autre qui, sur de bonnes ou hélas de mauvaises bases, se trouve, à un moment donné, idéologiquement dopé.
Un autre concept, fort important, est celui de bien collectif ou de bien public. Ce concept a été dégagé par les économistes mais il est couramment utilisé en politique. Pour une unité active donnée, j’appelle bien collectif tout bien à la fois non rival et non exclusif. Non rival, cela veut dire que les membres de l’unité active considérée peuvent consommer simultanément le même bien – contrairement à un beefsteak, qui est un parfait exemple de bien privatif. Non exclusif, cela veut dire non seulement que les membres peuvent le consommer en même temps, mais qu’il est impossible d’empêcher quiconque de le faire. Un programme télévisé semble a priori une bonne approximation de la notion de bien collectif. Mais, avec les systèmes de codage, il est possible d’empêcher des gens de le recevoir.
Un bien public est un bien collectif dans le cas où l’unité active est une unité politique. Nous avons donc les deux couples : unité active / bien collectif ; unité politique / bien public.
La question qui se pose immédiatement est : existe-t-il vraiment des biens collectifs ou publics ?
Il y a là une vraie difficulté. Quand on parle de bien en économie, on pense à une chose dont on peut disposer (dans l’état actuel de la technologie, un terrain sur Mars n’est pas un bien économique) et qui est mesurable (notion de quantité) ou tout au moins repérable (dans le sens où l’on dit que la température est repérable). Or les seuls bons exemples de biens collectifs ou publics qu’on sache donner ne sont ni mesurables ni même repérables. Ainsi en est-il de la « sécurité nationale » : toute évaluation monétaire des moyens est au mieux un indicateur grossier non pas de la quantité, mais du « degré » de sécurité supposé ; pareille évaluation revient en effet, du point de vue de l’économie néoclassique, à confondre la valeur de la production avec celle des facteurs mis en œuvre à cette fin. Autre exemple : est-il opérationnel, comme on l’entend tous les jours, de décréter que la « connaissance » est un « bien public », comme s’il suffisait d’ouvrir un livre de mathématiques pour en absorber le contenu, ou un livre de physique nucléaire pour fabriquer une centrale électrique ou une bombe ?
En réfléchissant à cette question, je suis arrivé à la conclusion que pour une unité active (ou politique) il n’existe en réalité qu’un seul véritable bien collectif (ou public) : c’est l’unité en tant que telle. Mais, de même que pour Platon, il y a le domaine des Idées avec un grand I, et celui de la réalité, dans laquelle le philosophe voit des « Idées dégradées », de même peut-on parler du Bien Collectif ou Public avec des lettres majuscules, et de biens collectifs ou publics « dégradés », lesquels sont des approximations mesurables ou repérables concrètes de l’idée qu’on peut se faire des biens collectifs ou publics. Étant donné la connotation péjorative de l’adjectif « dégradé », je parlerai plutôt de « pseudo-biens » collectifs ou publics. Ces pseudo-biens, ce sont les Organisations, c’est-à-dire les institutions qui dirigent l’unité active ou l’unité politique, qui les définissent, au nom de l’unité tout entière. C’est dire leur caractère relatif, puisque leur définition dépend des procédures de décision qui sont en règle générale le fruit d’une histoire beaucoup plus que d’une construction rationnelle. Par exemple, pour tous les gouvernements français depuis le général de Gaulle, la notion de Politique agricole commune (PAC) a correspondu à l’idée que la production agricole (notion quantitative) était un bien public (pseudo-bien dans ma terminologie), indépendamment de l’usage individuel que les consommateurs pouvaient en faire. L’idée sous-jacente est que l’agriculture contribue à façonner les territoires et l’organisation sociale, sous des formes auxquelles on est attaché. Naturellement, un tel point de vue n’a rien d’universel, ni dans le temps, ni dans l’espace, d’où les débats acharnés sur l’avenir de la PAC au sein même de l’Union européenne.
L’un des avantages de cette approche de la notion de bien collectif ou de bien public est qu’elle permet de concevoir la notion de gouvernance internationale comme le problème de la coordination mondiale de la production des pseudo-biens publics. En toute rigueur, il n’existe pas de bien public mondial, tout simplement parce que le monde n’existe pas, ou pas encore, en tant qu’unité politique. Ainsi n’est-il pas opérationnel de parler du climat comme d’un bien public mondial, même si dans certains discours l’usage de cette métaphore peut avoir l’avantage de forcer l’attention sur un problème réel et considérable, puisque le changement climatique pourrait conduire dans un petit nombre d’années à des mouvements migratoires portant sur des dizaines voire des centaines de millions d’habitants. Encore faut-il ne pas oublier que dans la réalité de la politique internationale, ce sont les États qui définissent des positions au nom des unités politiques qu’ils incarnent et qui négocient entre eux, selon des processus dont l’organisation est justement au cœur de la problématique de la gouvernance mondiale. Dans cette problématique, deux notions jouent un rôle particulier. Celle de leadership, qui suppose l’existence d’un leader, c’est-à-dire une unité politique capable d’attirer des followers en prenant en compte les intérêts de ces derniers ; celle de partnership, qui suppose une volonté commune des parties prenantes de dégager une formulation d’intérêts communs.
On peut faire des remarques analogues au cas du climat pour l’environnement au sens le plus large du terme, et d’une manière générale pour les situations, de plus en plus nombreuses en raison de la mondialisation, où les activités humaines provoquent à l’échelle planétaire des effets externes entre les pseudo-biens publics. Tel est typiquement le cas pour la santé des populations. Nous en avons longuement débattu l’an dernier au sein de la Commission du Livre blanc pour la Défense et la Sécurité nationale. Il pourrait y avoir des épidémies ou des pandémies incomparablement plus graves que l’affaire du virus H1N1. Imaginez par exemple qu’apparaissent des virus ayant des effets comparables au SIDA mais qui se transmettraient par voie aérienne : on pourrait connaître l’équivalent de la grande peste du milieu du XIVe siècle, qui a anéanti le tiers de la population européenne. Certains considèrent que la probabilité de pareil événement au cours du XXIe siècle est élevée. Comment affronter ce genre de risque ? Aussi bien du point de vue théorique que pratique, il ne faut pas, à mon avis, aborder ces questions en référence à la notion de bien public mondial, mais bien en termes de coordination de pseudo-biens publics interdépendants, liés aux unités politiques non pas telles qu’on en rêve, mais telles qu’elles existent.
La notion de conflit, et par conséquent le problème de la guerre, sont au centre de la politique internationale concrète. J’ai été très frappé lorsque l’un de mes collègues dans cette maison m’a parlé un jour de l’étonnement de ses élèves découvrant que l’entreprise était un monde de conflits. Et de fait, tout est conflit. Dès que vous entreprenez quelque chose, vous voyez surgir ce que j’appelle des unités actives contrevariantes, c’est-à-dire qui se fixent pour objectif de vous faire échec. Les conflits sont dans la nature humaine, et donc au cœur des problèmes praxéologiques de toute nature… même au sein du monde universitaire ou scientifique où les combats sont souvent féroces ! Et ils se situent bien sûr au cœur de la problématique de la gouvernance.
Il ne s’agit pas de prétendre éliminer tous les conflits. Ce serait naïf. L’enjeu, c’est d’améliorer sans cesse les modes de règlement des conflits. Il en existe essentiellement quatre : l’arbitrage, la négociation, la procédure et l’affrontement. L’arbitrage est couramment utilisé dans le domaine économique et commercial. La négociation est omniprésente, notamment dans les formes concrètes de coordination et donc de gouvernance. La procédure est liée à l’institution judiciaire, et donc très étroitement à la notion d’unité politique, d’où une distinction majeure entre droit interne et droit international. Quant à l’affrontement, il y a évidemment de nombreux degrés. Là aussi, il ne faut pas être naïf. Que de temps en temps deux personnes (physiques ou morales) s’accrochent franchement et se bagarrent n’est pas forcément très grave, cela peut même faire du bien. Mais il y a des formes d’affrontement qui dégénèrent jusqu’aux extrémités de la violence. D’où le problème de la guerre qui par essence, comme l’a théorisé Clausewitz, tend aux extrêmes. Nous sommes là dans la partie des relations internationales où l’épreuve de force se substitue à la gouvernance.
Sans tomber dans les erreurs et les naïvetés du pacifisme béat, je pense que le problème majeur sur le plan institutionnel d’une géopolitique positive est l’équivalent de celui dont je vous ai déjà parlé pour l’économie. Il consiste à assurer une coordination efficace, entre les États, de la production des pseudo-biens publics, le but principal étant de préserver la stabilité structurelle du système interétatique, et donc d’éviter les grandes crises systémiques. Il faut tout faire pour résoudre les conflits sans qu’on en arrive au stade de la violence extrême, génératrice de destructions et d’incertitudes dont l’expérience montre que le coût est finalement exorbitant pour toutes les parties en cause. La construction institutionnelle à tous les niveaux (national, régional ou mondial) de formes de gouvernance permettant de résoudre les conflits d’une manière pacifique – non pas, je le répète, de les éliminer, mais de les résoudre – est donc à mon sens la tâche la plus fondamentale et la plus noble à laquelle la « communauté internationale » puisse s’attacher. S’agissant d’une telle affirmation, je crois que la locution « communauté internationale » – contre laquelle je bataille habituellement – est justifiée, alors même que le monde n’est pas une unité politique et que l’ensemble des États constitue davantage une société (Gesellschaft) qu’une communauté (Gemeinschaft). J’insiste sur un point : la recherche de modalités pacifiques pour le règlement des conflits n’a rien à voir avec l’idéologie du pacifisme, laquelle serait sympathique si elle ne conduisait pas, le plus souvent, à l’opposé de l’objectif poursuivi.
Vous comprenez mieux maintenant le sens du titre de cette leçon : la géopolitique entre guerre et paix. Historiquement, la géopolitique a pris son premier essor comme un instrument idéologique au service de la guerre. Il n’est que temps de la mettre au service de la paix ; de la paix entendue, je le répète encore une fois, dans un sens constructif et non pas dans un sens naïf. Je vais vous donner très rapidement trois exemples.
Revenons d’abord sur la construction européenne. Pourquoi ai-je choisi, personnellement, d’adhérer à l’idéologie de la construction européenne ? Parce que cette idéologie, telle qu’elle a été mise en œuvre jusqu’à présent, a déjà démontré ses vertus pour résoudre pacifiquement les conflits internes, pour renforcer la prospérité des État mmembres, et pour rapprocher les attitudes de ces États dans leurs actions vis-à-vis de l’extérieur. Et qu’on n’objecte pas qu’il subsiste toujours des conflits d’intérêts entre la France, l’Allemagne, etc. Certes, il y en a et il en existe beaucoup entre unités actives qui appartiennent à un même État ! On ne le répétera jamais assez : il ne s’agit pas de supprimer les conflits mais de les transformer. Aujourd’hui, plus personne n’envisage dans l’avenir prévisible une guerre entre la France et l’Allemagne. Ce qui s’est passé après la chute de l’Union soviétique – typiquement la décomposition de la Yougoslavie –, transposé au début du XXe siècle, aurait vraisemblablement conduit à une guerre générale en Europe. Il reste d’ailleurs beaucoup de problèmes à régler, et ces problèmes sont plus ou moins bien traités, comme celui très actuel du Kosovo ; il subsiste bien des tensions, par exemple entre la Hongrie et certains de ses voisins où vivent des minorités nationales. Il n’empêche que l’élargissement de l’Union européenne a exercé un puissant effet pacificateur. C’est un résultat remarquable et il faut en être conscient.
Le second exemple est la maîtrise des armements au sens le plus large du terme. C’est toute l’histoire des relations entre l’Union soviétique et les États-Unis, après la crise des missiles de Cuba de 1962, où, pour éviter la reproduction d’une situation qui aurait pu conduire à un conflit nucléaire entre l’Union soviétique et les États-Unis, les deux États, tout en continuant d’être rivaux, ont entrepris de développer des méthodes coopératives grâce auxquelles la Guerre froide n’a pas dégénéré. À bien des égards, certaines de ces méthodes méritent d’être réactivées, comme l’a compris le président Obama.
Je mentionnerai enfin ce que dans l’Union européenne on appelle les tâches de Petersberg, c’est-à-dire les missions que nous assignons à nos forces armées en vue du maintien ou du rétablissement de la paix dans des régions en crise.
Tout ceci conduit à la question : comment peut-on, à partir des considérations précédentes, bâtir une gouvernance mondiale qui soit à la hauteur des grands objectifs énoncés ?
Je pense qu’il faut reprendre la copie à zéro. Mais quand je dis « à zéro », c’est une façon de parler, car on ne fait jamais table rase du passé. On est toujours héritier d’un système antérieur. Je suggérerai simplement quelques pistes qui me paraissent importantes.
La première, c’est la nécessité d’améliorer le système des Nations unies, dont l’efficacité et la légitimité doivent être renforcées. Les pays qui souhaitent devenir membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies doivent le justifier. C’est d’abord une question de ressources utilisables pour le bien commun. Les unités politiques qui occupent des positions de pôles dans le monde d’aujourd’hui, à la fois sur le plan économique et sur le plan militaire, sont peu nombreuses. Il y a certainement les États-Unis, la Chine, le Japon – avec le handicap de l’article 9 de la Constitution de Mac Arthur, qui interdit en principe tout recours à la force militaire même pour des tâches à la Petersberg –, la Russie – qui, comme le disait Bismarck, n’est jamais aussi forte ni aussi faible qu’on ne le croit –, et l’Union européenne, malgré la complexité de sa gouvernance. Peut-être faudrait-il ajouter l’Inde. Probablement pas ou pas encore le Brésil, qui n’est pas une puissance militaire. Le point essentiel est que, quel que soit le « G », c’est-à-dire pour tout groupe aspirant à jouer un rôle dans tel ou tel aspect de la gouvernance mondiale, l’appartenance peut être un droit, défini en fonction de critères objectifs, mais elle implique des devoirs. À mon avis, un des grands problèmes du Conseil de sécurité à l’heure actuelle, c’est qu’il n’y a pas d’accord opérationnel entre ses membres sur une charte de devoirs, une spécification des responsabilités allant de pair avec l’appartenance audit Conseil. Et cela vaut de la même façon pour tous les autres « G » que l’on peut envisager avec les différentes formes de la gouvernance mondiale.
Deuxième piste, c’est la hiérarchie entre les organisations véritablement internationales et les organisations régionales. Il est déraisonnable de penser qu’une organisation mondiale puisse résoudre tous les problèmes de la planète. Il faut donc disposer d’organisations régionales fortes conçues à des niveaux géographiques pertinents. C’est un point qui manque manifestement dans la structure de la gouvernance planétaire à l’heure actuelle. Par exemple, pour résoudre les problèmes du Moyen-Orient en général – vaste sujet –, et notamment la question iranienne, il est illusoire d’imaginer que l’on puisse aller loin si les pays les plus concernés ne sont pas associés dans un système régional bien organisé. Tant que l’Iran sera isolé, on ne pourra pas progresser. Et l’on ne pourra pas progresser non seulement dans le dossier nucléaire iranien, mais encore dans d’autres dossiers essentiels comme l’Irak. Car un nouvel ordre structurellement stable en Irak est inconcevable sans le concours de l’Iran. L’exemple de l’Iran nous renvoie aussi au point précédent. Lorsqu’un État manifeste un comportement révolutionnaire, c’est-à-dire rejette les disciplines afférentes à toute notion d’organisation régionale ou mondiale, et engage dans ses actions des ressources telles qu’il puisse en résulter un dysfonctionnement majeur pour le système international dans son ensemble, il appartient au Conseil de sécurité de se saisir de la question. Mais celui-ci ne peut le faire constructivement que si ses membres partagent une culture coopérative exprimée dans cette charte de devoirs, que j’ai appelée de mes vœux.
Un troisième domaine de réflexion, c’est la complémentarité entre la sécurité collective, associée à des institutions internationales, et l’équilibre des forces, balance of power comme on dit en anglais. On a l’habitude de les opposer, mais les deux concepts sont à mon avis complémentaires, à tous les niveaux d’organisation. La remarque vaut même à l’intérieur de l’Union européenne. Celle-ci ne serait pas structurellement stable si l’un des États membres dominait tous les autres. Après la chute du mur en 1989, certains ont pu craindre, à tort, que ce ne devienne le cas avec l’Allemagne réunifiée. C’est pourquoi le « modèle » de l’Union européenne n’est pas simplement transposable à des régions marquées par la domination d’un État. D’une manière générale, une question majeure pour la gouvernance mondiale est la possibilité de définir un découpage régional pertinent, ce qui renvoie à des considérations géopolitiques, dans le sens précis que j’ai donné à ce terme (idéologie relative aux territoires). Ce n’est pas simple.
Je conclus. Il est clair à mes yeux que l’humanité est confrontée aujourd’hui à la question de sa survie. Quand vous parcourez l’histoire universelle depuis deux siècles, vous constatez une explosion surexponentielle de tout, à commencer par la démographie. La révolution des technologies de l’information, dans la seconde moitié du XXe siècle, a bouleversé le monde. Ses conséquences dans les prochaines décennies sont largement inimaginables. Je me demande parfois à quoi ressemblera notre planète en 2100, en 2200. Le 28 août 2287 la planète Mars s’approchera de nous encore plus que le 27 août 2003. Fascinante précision de la mécanique céleste. Mais qui peut imaginer le monde en 2287 ? Il y a une chose que je sais, c’est que si les hommes ne se montrent pas capables d’apprendre à s’organiser pour assurer la coexistence pacifique, et au-delà la coopération entre unités politiques hétérogènes, la trajectoire humaine sombrera dans le chaos. Tout se jouera sans doute au cours du siècle qui commence. C’est dire qu’à l’échelle de l’histoire il y a urgence.
Certains peuvent penser « après moi le déluge ». Tout dépend en effet de l’idée qu’on se fait de la condition humaine. Souhaitons-nous – autant que faire se peut – protéger le genre humain jusqu’à ce que survienne un événement imparable comme ce météorite qui aurait frappé la Terre et l’aurait enveloppée d’un nuage impénétrable pendant des mois ou des années, il y a soixante-cinq millions d’années, avec entre autres conséquences l’extinction des dinosaures ? Avons-nous une quelconque responsabilité face à notre destin collectif ?
Notez que la question que je viens de poser est proche, conceptuellement, de deux idées parmi les plus discutées, qui sont le « développement durable » et le « principe de précaution ». Ce sont deux notions pratiquement identiques, qui ramènent à la problématique de la gouvernance internationale comme coordination des pseudo-biens publics au sein d’institutions chargées en l’occurrence d’appréhender les différentes formes du risque ou de l’incertitude et de décider des attitudes collectives à leur égard.
Au terme d’une période de quarante-cinq années pendant lesquelles je n’ai jamais quitté l’École polytechnique, avec près de quatre décennies d’enseignement de la science économique (entre 1975 et 1992, à la totalité des élèves), puis des relations internationales, je vous dirai simplement, mes chers camarades, que j’ai très tôt choisi de croire à la liberté et à la responsabilité partielle de l’homme face à son destin, et d’orienter ma vie en conséquence.